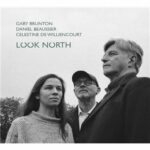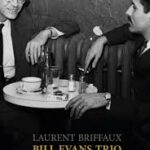Festival Comme ça vous chante #9 – Pougemin, 9-11 septembre 2022
Cette édition anniversaire de « Comme ça vous chante » (le 10e avec une année off) fut l’occasion de résumer l’esprit de ce festival qui n’est pas un festival de jazz, mais beaucoup mieux que cela : un lieu où souffle un esprit qui permet au jazz de s’offrir soustrait aux déterminations du genre : simplement, comme musique.

Dans ces champs de Charente où le maïs peine à traverser l’été, Edward et Veerle ont créé avec le « Fish & chips Pougemin » une enclave propre à accueillir ce que le monde comme-il-va s’ingénie à étouffer sous lui. Ils ont inventé une façon à eux, énergique et joyeuse, de partager tout ce qui se peut dans un lieu inventif à leur image. C’est ainsi qu’oubliés des clubs de jazz pendant des décennies – les « vrais », ceux de Paris ! –, Trevor Watts, Veryan Weston, deux pionniers de la scène anglaise de l’improvisation ont été accueillis à bras ouverts par Pougemin avec Jamie Harris sous le nom d’Eternal Triangle, à la grande surprise et pour le plus grand bonheur de ceux qui n’ont pas la mémoire courte comme de ceux qui les découvraient sur le tard.
Le festival Comme ça vous chante a donc posé ses valises à Pougemin pour la deuxième année, qui est aussi celle de son dixième anniversaire.
Cette édition se présente un peu comme un résumé de ce qu’a été ce festival : un espace ouvert sur tous les horizons, à toutes les musiques, en ménageant une agora où elles peuvent converser librement en restant elles-mêmes : le résultat non d’une intention, le plus souvent démagogique, mais d’une attention à, simplement, ce qui est, autour de soi, et de ce qui, par-delà les genres, fait musique.
Un soir au club
Une salle avec une mezzanine comme une tribune d’orgue et un long bar de saloon a donc été la scène où s’est rejoué, pour commencer, l’éternel grand écart qui, depuis ses origines, aura longtemps modelé le destin du jazz : que ce soit au cimetière, au bordel, ou au speakeasy, cette musique a dès sa naissance dû se frayer un passage dans des lieux, au travers de circonstances, d’émotions ou de désirs autres, ivresse des sens ou salut des âmes. Pougemin, ce 9 septembre, c’était le club de jazz sans la fumée : rumeur ininterrompue des conversations, éclats de voix, de rires, choc des verres, et se frayant un passage, Equinox, soit l’association d’un pianiste, Jean-Christophe Kotsiras, et d’un contrebassiste, Philippe Monge, plus que frottés des ambiances de la rue des Lombards. Ils dirent leur plaisir – et leur amusement « Nous on joue ; vous, vous mangez » – de les retrouver ici déplacées dans un contexte qui en renouvelait le sens. Identifier dès les premiers accords chacun des morceaux du répertoire est un des comportements par lesquels on reconnaît infailliblement l’appartenance d’un auditeur quelconque au taxon « amateur de jazz », généralement situé au premier rang.
Mais dans une set list qui, d’Alan Broadbent à Thad Jones, de Sonny Clark à Hampton Hawes et Horace Silver empruntait de préférence les chemins de traverse, il fallait bien Bobby Timmons pour jalonner d’un kern rassurant une randonnée au cœur d’un paysage peu fréquenté où quelques compositions du pianiste confirmaient ce que l’on savait déjà : les vrais compositeurs sont rares en jazz, et Kotsiras en est un. À défaut de panneaux indicateurs, le panorama demeurait familier puisque l’on pouvait accompagner une pièce sur deux par un claquement de doigts (« On distingue, en gros, deux catégories d’amateurs de jazz, les calmes et les agités »). Tirées des profondeurs du catalogue hard-bop, Blues in a Jiff (Sonny Clark), Hip (Hampton Hawes) et, donc, ce Dat Dere de Bobby Timmons, ainsi qu’un standard bien connu (I’m getting sentimental over you), joints à l’accompagnement d’une classique walking bass, mettaient sur les rails un jazz tout-terrain. Pour des oreilles plus désireuses de percer le jovial mur du son, ici des volées de notes, là des contrastes accusés – sur Hip, le riff d’origine ici soudain tiré comme un trait en travers de son thème –, de brefs changements de mesure, une solide main gauche où se dessine une échappée possible, tout cela trahissait des préoccupations moins conventionnelles. Si déjà l’ouverture par un Journey Home plutôt rêveur (Alan Broadbent), un Lady Luck (Thad Jones) débonnaire et enjoué, le chaloupement d’une samba chère à Stan Getz (Menina moça de Luis Antonio) ménageaient des points de fuite à cette randonnée, le superbe Alumina de Kotsiras lui-même ouvrait des perspectives sur un horizon plus lointain où, dans son ressac, il semblait apercevoir la mer. Dans le même esprit, Freddie Redd (un Ole version tango), Horace Silver (Soulville, agrémenté d’un chorus de basse doublé façon Slam Stewart), un Waiting for Charlie (Broadbent) dont le titre ne renie pas ses origines même si le Charlie en question n’est pas nécessairement celui auquel on pense, d’autres originaux enfin dont on espère qu’un disque rendra publiques et plus largement partageables les émotions qu’elles suscitent, renouvelées à chaque audition[1]. Le critique gagera que ce n’est pas fortuit ! (« Oui, mais, ce que la critique pensait et ce que moi je savais. » ? songe le musicien). Pas plus que le choix du dernier morceau, un morceau de choix : quiconque a été foudroyé par Mary Lou Williams illuminant à jamais It’s a grand night for swingin’ comprendra que, sous les étoiles dans les champs de maïs, ce soir au club tenait d’autres promesses que celles « d’un club pas mal en ville ». Pour jouer tout à fait l’illusion, une jam fit bonne mesure – quoiqu’en réalité, l’adjonction d’un ténor décidément tristanien déportait encore un rien le code. Ce n’est que bien plus tard qu’on put conclure : « Le jazz. Ça suffisait pour ce soir.[2]»
Interlude – le jazz en perspective
Cette édition anniversaire de Comme ça vous chante fut l’occasion de résumer l’esprit de ce festival qui n’est pas un festival de jazz, mais beaucoup mieux que cela : un lieu où souffle un esprit qui permet au jazz de s’offrir soustrait aux déterminations du genre : simplement, comme musique. Ce qui est tout autre chose ; mobilise une autre perspective d’écoute. Où même la musique surgit au sein d’autres formes narratives : ainsi est-elle appelée dans un charmant conte musical du samedi, Le rêve de Singalé (Julie de Oliveira et Luc Diabira), où un balafon est l’objet d’une quête initiatique. Dans sa simplicité, il est fait beaucoup avec peu. Le dimanche, elle était tout à fait absente de Trois reines à la rue, un spectacle de clownes dans lequel on retrouvait Anne Danais, partenaire dans d’autres contextes d’Alice Rosset pour de belles lectures accompagnées[3]. Pour l’occasion, une reine étant curieusement absente ce 11 septembre, elle jouait avec Frédérique Le Naour sur les registres de la dérision, voire d’une provocante rosserie, une partition où la colère et l’amour sont des sentiments réversibles, où l’on distribue les baisers à la mitraillette et au bazooka, et où la folie shakespearienne – jouée littéralement – finit à l’Ehpad, au département Alzheimer. Et si la musique était absente de cette clownerie au réalisme cru, l’improvisation, elle, y tenait sa place.
Au total, quatre autres concerts déplaçaient la mire auriculaire. Deux d’entre eux, le samedi et le dimanche, permettaient d’entendre l’Ensemble éphémère réuni par Alice Rosset, différent chaque fois, et qui chaque année monte de façon expresse des pièces classiques : cette fois dans des programmes plutôt rares, un trio composé d’Alix Gauthier (alto), Alice Rosset (p) et de Yaëlle Quincarlet (violoncelle). Ce leur fut l’occasion de ressusciter deux rares duos de Rebecca Clarke (Berceuse et Grotesque) et de conclure par le trio op. 114 de Brahms dans sa version pour alto. Le samedi, un duo inachevé de Glinka, et le dimanche la Sonate « Arpeggione » de Schubert – excusez du peu – complétaient un concert émouvant chaque fois tant par la musique jouée que par l’engagement des musiciennes. Ce n’étaient pas des interprétations longuement rodées, annoncées des mois à l’avance et présentées avec une faveur aux heureux possesseurs de tickets. C’était, servie brûlante au sortir de trois jours de répétitions prises sur l’organisation du festival, la musique comme fraîchement éclose, d’une incomparable fraîcheur. Il faut tout le talent de ces musiciennes pour restituer sans l’ombre d’une approximation ni d’un laisser-aller la sève de ces partitions et l’offrir à un public ami : l’esprit d’une schubertiade en quelque sorte. Un Marlboro sur Charente.
Ce concert classique de la fin d’après-midi avait été lui-même précédé et suivi le samedi par deux moments également étonnants, mais pour des raisons fort différentes. L’ensemble A Piacere associe quatre musiciennes que leurs instruments n’appelaient pas forcément à partager la scène : cajón, calebasse, glockenspiel, vibraphone, violoncelle et voix. Sans oublier un quatuor d’éventails que n’aurait pas renié Aperghis ou Kagel. Quiconque a assisté à un concert d’été en Espagne peut imaginer le parti à tirer d’un geste endémique à nul autre pareil : déploiement, scansion, sourire. En lequel se résume l’esprit et la matière d’A Piacere. Dans un espace tout de transparence, épinglé par des petites percussions allégées au possible, les airs prennent librement leur essor, depuis les voix ou le violoncelle, le vibraphone jetant le pont entre le rythme et la mélodie. Des airs, des chansons, des ritournelles venus des quatre coins du monde, et de Camille à Berio (Folksongs), de Brel au reggae, à Madredeus, au bluegrass, au Cant dels ocells arrangé par Jordi Savall… La fraîcheur balaye tous les étages d’une construction aussi solide et subtile qu’une architecture tropicale. Une même brise porte les voix, les timbres associés par des orchestrations aérées qu’autorise la souplesse de l’ensemble. Un fil de la vierge luisant au soleil, et un sourire de chat qui flotte. Un mobile au vent, en somme.
Le soir tomba sur l’autre surprise du jour : un duo de guitares comme peuvent en rêver les plus blasés, ou plutôt une guitare, celle de Sébastien Giniaux, accompagnée, puisque son complice attentionné, précis, Joris Viquesnel, ne se départit guère d’un rôle dont il atteste la noblesse. C’est par sa conclusion de leur concert sur Le déserteur que l’on comprendra mieux ce qui porte Sébastien Giniaux. Le versant éthique du message de Boris Vian lui tient lieu de viatique pour franchir toutes les frontières, passant d’un continent à l’autre, d’une tradition musicale à une autre – du Brésil à l’Afrique, de Mozart aux Balkans – tout en restant absolument lui-même, déserteur dans l’âme. Bien connu dans le cercle des guitaristes, et notamment celui, un peu à part de la guitare manouche où il fait désormais figure de star, il reste buissonnier et s’est donné pour cela tous les moyens, la virtuosité n’étant qu’une façon de donner des ailes à une imagination sans limites. Qu’il offre à son tour une version d’Alfoncina y el mar qui a fasciné tant de musiciens de tous horizons, Mercedes Sosa comme Bobo Stenson ou Avishai Cohen, où des affleurements manouche se remarqueraient à peine ; que ce soient des mandolines vivaldiennes qui soudain gondolent dans l’adagio du 23e concerto pour piano de Mozart ; que sous ses doigts sa six cordes se métamorphose en kora ; que passant au travers de sa caisse une cuíca pointe son nez pour enfiévrer discrètement une samba, c’est toujours sur un fil mélodique aussi rigoureux qu’inventif, libre. Une pièce dédiée à sa fille de deux ans, Futur, est à ce titre emblématique : bâtie sur des suspensions qui n’empêchent pas le courant d’aller, elles sont comme autant de portes ouvertes sur des paysages qui restent à deviner : la vie, quoi. Avec une déconcertante facilité, Sébastien Giniaux, les yeux dans le vague, tire de la musique des phrasés les plus acrobatiques : faisant fi de tout cloisonnement, s’il a trouvé le trou par lequel enfiler les perles d’un programme aussi divers, c’est que le fil qui les relie est celui-là même de la musique. Ce trou, est aussi celui par lequel se faufile le déserteur.
Ces deux concerts du samedi encadrant le moment classique de la journée donnaient ainsi la mesure de l’ambition du festival. On y touchait au fondement même de l’amour de la musique.
Musique
C’est ainsi que le lendemain, le quatre-mains d’HasinAkis prenait tout son sens. La mise en avant de l’articulation « jazz et classique » pourrait paraître, dite ainsi et reprise telle quelle par le journalisme quotidien, un rien publicitaire. Avec Alice Rosset et Jean-Christophe Kotsiras sur une scène ou une autre, publique ou privée, on sait qu’il s’agit de tout autre chose. Dans leurs concerts, quelque chose est à l’œuvre qui travaille l’écoute elle-même en la dépossédant de ses repères, ce pourquoi sans doute ils ne présentent jamais les pièces ni ne les individualisent lorsqu’ils les listent dans leur globalité à la toute fin. Si les quatre premières compositions sont de Kotsiras, dont ces superbes Why not et Emelia, la cinquième est un medley pour ouvrir cette boîte de Pandore qu’est une prestation d’HasinAkis. Plutôt que d’enchaîner des pièces dans leur unité plus ou moins identifiable, ils procèdent par fragments ; quelques mesures, un intervalle débouchant sur l’esquisse d’un thème, qui disparaît résorbé, reparaît plus loin, transfiguré. Quelques mesures touillées dans le grave d’une vision fugitive débouche sur un indice tiré de Gershwin, lequel se dissoudra dans un blues à son tour avalé mais d’où surgiront les premières mesures emblématiques de Night in Tunisia, emporté par un train qui ressortira une poignée de stations plus tard. Entre-temps la vison fugitive se sera précisée sous les doigts d’Alice Rosset qui l’a intégralement rendue à Prokofiev (la deuxième) suivie d’une autre (la vingtième). Les places échangées, des thèmes superposés (Kari’s trance/Hi Beck),une pièce de Kotsiras (Neo Zeïbekiko) qui rebondit sur les résonances obstinées de la sixième Children song (Chick Corea), et revoici E Train, sorti d’un long tunnel. Plus loin, c’est le balancement de main gauche qui évoquera l’ostinato coréen, mais entre-temps on se sera bercé dans le ressac rêveur du splendide Davida Bella (Clare Fischer). Nul brassage cependant, mais un cadrage-débordement finement calculé qui ouvre la voie vers ce fond convoité d’une musique « en général », à partir duquel ses territoires particuliers apparaissent désormais sans limites[4].
Le jazz, tout retourné
C’est donc d’une autre oreille, une oreille retournée, qu’après le second concert de l’Ensemble éphémère (Clarke, Brahms, Schubert, Chostakovitch pour finir), nous avons retrouvé Jean-Christophe Kotsiras en quintet, avec Lennie’s : Ludovic Ernault (as), Pierre Bernier (ts), Blaise Chevallier (b), Ariel Tessier (dms). Une formation aussi classique qu’un quatuor à cordes pour un répertoire dû pour moitié à la plume de Kotsiras et, pour le reste, aux piliers de la première garde tristanienne. Débuter par Anamnèse (Kotsiras), un thème qui se fait en se défaisant et recourt pour cela à des jeux de miroir,était une façon de montrer que l’histoire du jazz est un réservoir auquel on accède par les plongées successives d’une remémoration toujours à recommencer, plongées qui constituent elles-mêmes les strates de cette histoire. La paire de saxophones, rompue à cet exercice d’ensembles où chatoie le timbre fantôme de leur unisson, donnait le ton par sa mise en place impeccable. La batterie, elle, prenait l’air à la surface. Loin du retrait exigé par Tristano afin de ne pas briser la linéarité de l’esthétique mise au point ni d’en contredire la répartition savante des accents, Ariel Tessier a imposé sa présence de la première à la dernière note, dans un souci hyperréaliste du détail, au risque, pour autant bien négocié, de la redondance. Le bref Marionette (Billy Bauer) qui suivit jeta un nouvel éclairage sur les possibilités du quintet en dissociant le trio rythmique des souffleurs, lui autorisant sur la voie tracée par le piano des digressions de plus en plus abstraites jusqu’à obtenir un flottement contrôlé de blocs à la dérive qui, loin de cesser au retour du thème par les saxophones creusa dans celui-ci des cavernes d’Ali Baba aux scintillantes richesses – dans l’ombre. Shining (Kotsiras) montrait alors comment pouvait se déplacer cet héritage tristanien dans une optique plus au goût du jour, un jour occupé notamment d’énergie. Non qu’il en manquât en son temps, mais on en mesure d’autant mieux la teneur. La manière dont progressivement le ténor enfla tout en l’espaçant son discours au gré des montagnes russes d’un thème qui lui-même relançait habilement les dés. Avec une batterie vivante pour animer les ensembles, jouant des nuances des cymbales, ponctuant de roulements de caisse claire les nombreuses relances au pied du col, un piano plus attaché à commenter qu’à un discret comping, une contrebasse fermement assise, ronflant d’aise, le ténor pouvait donner à un discours réfléchiune orientation parfaitement contemporaine, et à mesure qu’il distillait ses notes, la rythmique occupait, profuse, épanouie, tout l’espace. Le même trio introduisit longuement It’s you (Konitz) avant que le duo de tête ne rejoigne le piano dans son exposé du thème, formulé enfin explicitement et repris plus tard à trois voix, décalé, en canon, lorsque le piano les eut rejoints. Entrer dans le détail permettrait peut-être de restituer les constructions savantes des arrangements, à l’œuvre tout au long, dans les dialogues dilacérés et leur reprise de Wow ! (Tristano), les allers-retours concertants d’Emelia (Kotsiras) que l’on venait d’entendre à quatre mains, la suave rêverie à deux saxes en prélude au feu d’artifice de Palo Alto avec son duo basse-batterie à découvert où Tessier lâche ses coups accompagné d’un Chevallier puissant, impavide. En revanche il fallait être là pour se réjouir de partager avec Kent Carter soi-même son approbation, l’œil brillant, l’engagement de Blaise Chevallier. Avec un gros son, il avait une façon à lui d’assurer un drive de remorqueurtout en faisant chanter sa contrebasse dans le creux des vagues qui peut-être atteignait des secrets enfouis.
Chaque pièce, à sa façon, illustrait la tension entre ordre et désordre – à condition d’entendre par « désordre » le simple empilement d’ordres de raisons différentes, lesquels peuvent assurément en se croisant se rejoindre. Proposé pour clore un concert qui se prolongera néanmoins par le Me and you de Lenny Popkin, c’est un titre de Lee Konitz qui l’illustrera, celui-là même qui donne son nom au quintet : Lennie’s. La scansion martiale qui n’est pas sans rappeler celle qui généralement introduit Cherokee, se poursuivra sans fléchir jusqu’au bout d’un long périple au cours duquel, piano, basse relaieront la batterie pour lui faire une fois encore, émergée, enfouie, toujours active, revêtir des aspects ou des fonctions divers. Libérer fûts et baguettes, ancrer le thème, appeler de forts contretemps sous le soliste et ouvrir par là de nouveaux espaces émancipés – dans lesquels le piano pourra, surprise, être amené à jouer « cubain » à la suite d’un solo d’alto qui aura poussé du coude les barres de mesure ! – une façon de réinterpréter la création de lignes de fuites propre aux tristaniens : par la polyphonie et l’usage des accents. À cet égard, il n’est pas indifférent que ce soit un pianiste des plus rigoureux, voire « sévère », qui ait le premier frayé les voies d’un jazz qu’on pourrait qualifier de « free ». Et c’est là, au-delà des évidences – la formation du quintet et l’obédience west-coast des saxophonistes –, ce qui, plus profondément peut-être, révèle la vraie raison d’être de Lennie’s : trouver une actualité, en 2022, à cette « école ». Ce Lennie’s enflammé est la preuve qu’il y a encore bien des choses à soutirer d’une musique qui fut en son temps qualifiée de « fraîche », tout en restant fidèle à ses principes directeurs.

Il n’y avait pas de meilleure façon d’accuser la pleine dimension d’un festival qui pourrait constituer un modèle idéal. Inimitable dans sa façon d’être conduit, mais l’étalon tout de même pour tout autre dans la mesure où il est confié à la musique de conduire à son essence secrète. Ce que les mots peuvent difficilement exprimer sans être suspects d’enflure rhétorique, et d’exagération parce qu’un simple Fish&chips aux confins intérieurs et ruraux de la Charente-maritime en est la scène. Pourtant…
Philippe Alen, texte
JC Pratt, photos
[1]Comptes rendus de concerts d’HasinAkis : Improjazz, 2019 ; La Gazette bleue d’Action Jazz ; La Gaztte bleue : Festival Comme ça vous chante 2021
[2]Ces citations en italiques sont empruntées au livre de Christian Gailly, Un soir au club (Minuit, 2001). C’était aussi le titre de Jean-Christophe Kotsiras joué ce soir-là.
[3]En attendant Rosa (sur un texte de George Sand) ; « Et si Duras aimait Bach » ; Récital-Lecture « Chopin-Sand »
[4]Jean-Christophe Bailly n’a de cesse, dans Le propre du langage, de pointer les affleurements de ce « fond évadé » que les mots peuvent toucher « comme une sonde ». (Le propre du langage, « Sonde », p. 188-9).